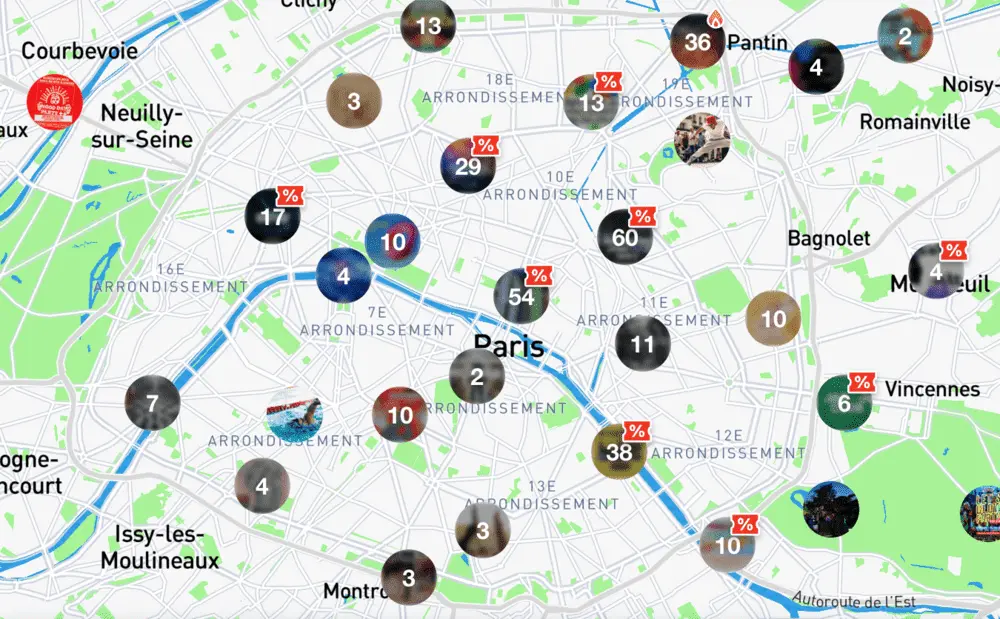Sommes-nous trop sensibles ?
Description
Trop sensibles ou mal sensibles ? L’époque paraît tout autant marquée par une vague d’hypersensibilité émotionnelle que par une forme d’indifférence collective. Que dire de ce paradoxe ?
La neuroscientifique Samah Karaki nous raconte dans son livre L’empathie est politique (JC Lattès, 2024) comment l’empathie se révèle foncièrement faillible et sélective, influencée par nos biais sociaux et idéologiques. Elle invite ainsi à reconnaître les limites de notre capacité à ressentir ce que vivent les autres, et à construire des formes d’attention plus conscientes, plus volontaires, plus politiques.
Anne Muxel, sociologue et politologue, explore quant à elle les sensibilités de la jeunesse française et européenne, parfois qualifiée – non sans condescendance – de « génération snowflake », trop fragile ou vulnérable. Ces jeunes de 16 à 35 ans grandissent et se construisent dans un monde traversé par des crises multiples : politiques, écologiques, sanitaires, institutionnelles et morales. Leur sensibilité accrue face aux injustices ou à l’incertitude ne traduit-elle pas plutôt une forme de lucidité ? Cette rencontre propose de réfléchir à ce que notre rapport au sensible dit de notre manière de faire société aujourd’hui.
Samah Karaki et Anne Muxel interviendront toutes les deux pour éclairer ce paradoxe du "trop" ou "mal" sensibles lors de cette rencontre qui sera modérée par la journaliste Lou Héliot, rédactrice en chef adjointe du 1 Hebdo.
Cette rencontre fait écho au numéro 530 : Sommes-nous trop sensibles, du 1 Hebdo, paru en janvier 2025.
+ d'informations :
Samah Karaki est docteure en neurosciences et autrice. Elle a fondé et dirige le Social Brain Institute (SBI), une association qui utilise les savoirs de la science cognitive pour gérer des enjeux environnementaux et sociaux. Après Le talent est une fiction (2023), véritable succès critique et public, elle publie L’empathie est politique aux éditions JC Lattès en 2024.
Anne Muxel est directrice déléguée du CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po) et directrice de recherches émérite en sociologie et en science politique au CNRS. Ses travaux dans le champ de la sociologie politique s’attachent à la compréhension des formes du lien des individus à la politique et plus largement au système démocratique, à partir de l’analyse de leurs attitudes et de leurs comportements (nouvelles formes d’expression politique, rapport au vote, modes de socialisation et de construction de l’identité politique). Elle a mené de nombreux travaux sur la transmission des valeurs dans la dynamique générationnelle et est une spécialiste reconnue des études sur la jeunesse. Elle a aussi ouvert un champ de recherches consacré à une sociologie de l’intime, qu’elle développe au travers de questions touchant à la politisation des individus, à la construction de la mémoire individuelle et collective. Ses derniers ouvrages sont : L’Autre à distance. Quand la pandémie touche à l’intime, (Odile Jacob, 2021), avec Adélaïde Zulfikarpasic, Les Français sur le fil de l’engagement, (L'Aube/Fondation Jean Jaurès,2022), avec Martial Foucault, Une jeunesse engagée (Presses de Sciences Po,2022), avec Bruno Cautrès, Le vote sans issues (PUG,2025).
Communauté
Toutes les offres
Ces prix incluent les frais de services appliqués par les distributeurs.
16:00- 18:30