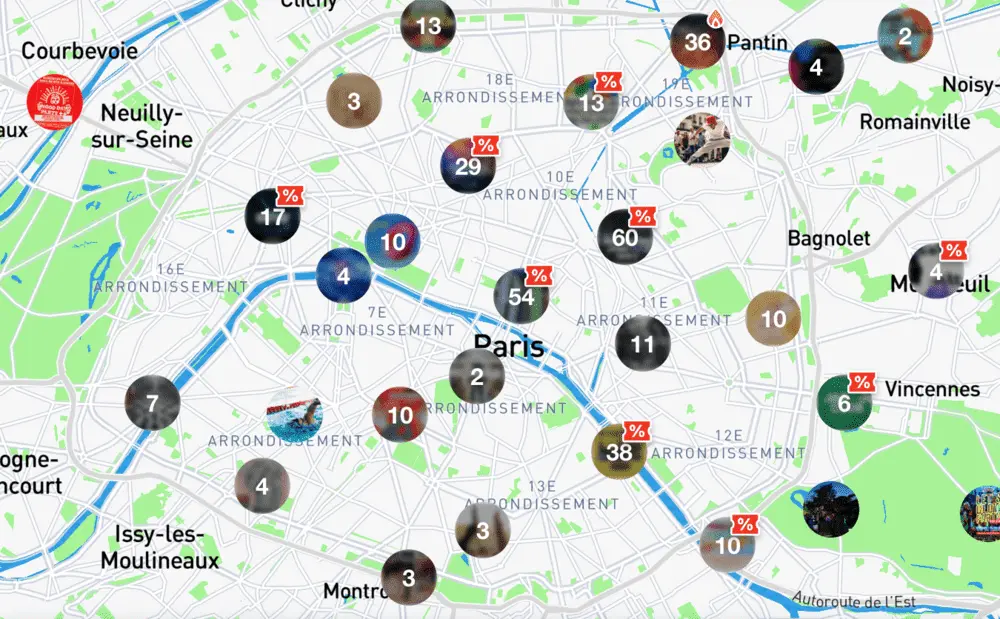Exposition De Rendez-vous en Rendez-vous à La Galerie du Haut Pavé
Description
Cette Exposition permet aux Artistes ayant exposé les années précédentes d’avoir l’opportunité d’un deuxième Rendez-vous Nous avons le plaisir en cette rentrée d’ouvrir nos portes à : Anne Dasilva, Aurélie Denis, Maximilien Hauchecorne, Hélène Neraud, Aurélie Scouarnec, Ines Spanier et Longjun Zhang.
Tamaris Borrelly : Souvent, enveloppés dans un brouillard très doux et duveteux, des êtres animés, des plantes et des pierres se blottissent et se serrent les uns contre les autres, comme s’ils fusionnaient en un seul corps.
En floutant les limites entre les êtres et les choses, l’espace et le temps le travail de Tamaris Borrelly appelle à la rêverie métaphysique. Les langages qu’elle emprunte, faits de matière souvent organique et mouvante questionnent la matérialité et la substance des choses. Ils nous rappellent que les molécules peuvent s’assembler en une multitude d’éléments, que le fer dans la terre peut constituer une roche, qu’il peut couler dans nos veines, dans celles de l’oiseau et du rat, ou circuler dans la sève d’un arbre. Mais ils ne font pas simplement référence aux règles qui régissent notre monde, ils s’en affranchissent pour s’autoriser toutes les hybridations, toutes les transfigurations. La nature y est retranscrite rêvée et magnifiée, luxuriante. Elle n’est pas simplement esthétisée, elle parle de l’espace, du vide, du temps, de la matière, des choses et de leurs délimitations, du début et de la fin.
Aurélie Denis : Auteure et plasticienne, Aurélie Denis vit et travaille à Paris. Sa pratique fait entrer en résonnance écriture, dessin et performance ; c’est une enquête sur les trajectoires, les temporalités et les potentialités d’un corps. Dans ses performances et sa danse, elle joue avec le contrôlé et l'incontrôlé, le geste maîtrisé et le réflexe, la lenteur et les accélérations. Les mouvements et le placement de son corps dans l'espace sont le fruit d'un travail raisonné, d'une compréhension fine des sensations internes, la proprioception.
Lors de ses études à la HEAR (Haute École des Arts du Rhin, Strasbourg), puis à la Saint Martins College of Art (Londres), Aurélie Denis met en scène ses sculptures et son propre corps dans ses performances et ses photographies. Elle puise dans son quotidien des éléments qu’elle intègre à sa recherche formelle.
Elle se tourne vers l’écriture et la lecture-performance pour construire un récit autofictionnel sur la réappropriation de son corps après un accident survenu à Londres. Le Taxi est publié en 2010 aux éditions Esperluète.
Maximilien Hauchecorne : Utilisant l’encre de Chine et la plume, parfois sur un tirage cyanotype, les dessins de Maximilien Hauchecorne commencent par un noir intense, introduisant une géométrie raffinée sur le blanc du papier. L’aube commence par l’obscurité, et l’architecture déploie ainsi une intégration lente et régulière de la lumière, révélant des formes cylindriques aux formes elliptiques variées. Des couches successives de lignes tracées à main levée explorent une préoccupation pour le volume au-delà de ces seules formes, son corpus d’œuvres s’étendant sur une vaste échelle, de 180 cm à la largeur d’une paume. Les cahiers qui se déplient et se déplient à nouveau en une multitude de croquis du monde naturel, imitant la narration du flux de conscience rendue célèbre par « Mrs. Dalloway » de Virginia Woolf.
Maximilien Hauchecorne fait un geste vers les irrégularités que la lumière projette dans son travail, des nuances et des motifs tissés dans les superpositions successives, qui sont indéniablement humaines. Inspiré par l’ouvrage « L’Éloge de l’Ombre » de Jun’ichiro Tanizaki, sa pratique témoigne d’une volonté de prendre conscience de la richesse de notre expérience quotidienne, si ces textures et transitions – de l’ombre à la lumière et inversement – peuvent être ressenties dans l’instant vécu.
Hélène Neraud : Hélène Néraud est née en 1986 à Mont Saint Aignan, elle vit et travaille à Rouen.
Diplômée de l’école des Beaux arts de Rouen en 2010, elle mène une pratique artistique qui met en place un dialogue entre peinture, céramique et photographie et qui s’articule autour de la notion d’exploration de la pensée et de la mémoire du paysage, spécifiquement autour des paysages de haute montagne.
Il s’agit donc d’une recherche de reconnaissance, une tentative de mise au point et d’un éclairage sur une exploration presque mystique des territoires de grande solitude
Par ailleurs, la couleur est au cœur de ses préoccupations de forme et d’espace.
Aurélie Scouarnec : Aurélie Scouarnec (née en 1990) est une photographe qui vit et travaille à Paris. Elle a été lauréate de la Bourse du Talent en2021, finaliste du Festival International de Photographie de Hyères en 2018.
Son travail a été présenté à la BnF en 2021, à la galerie l’Imagerie à Lannion en 2020 ainsi que dans différents lieux ces dernières années. Elle vient d’obtenir en 2022 le Soutien à la Photographie Documentaire contemporaine du CNAP pour un nouveau projet. Un livre est prévu en 2023 aux éditions Rue du Bouquet.
Ines Spanier : « Ines Spanier s’intéresse à l’exploration graphique des structures matérielles, qu’elle poursuit jusqu’au gros plan microscopique. L’élément de temporalité joue ici un rôle décisif, tant dans la durée du travail de dessin que dans le choix des motifs. Elle préfère les motifs qui sont dans un état d’altération et de dissolution, des matériaux qui vieillissent évidemment avec le temps. Dans un premier dessin de 2009, elle représente un seul segment de corps sous la forme d’un paysage de peau en expansion semblable à un vortex. La dimension cosmique et organismique qui caractérise ses travaux ultérieurs est déjà prédéterminée dans ce travail initial.Ines Spanier ne pratique pas l’hyperréalisme stéréotypé, mais développe son travail devant un horizon ouvert de conscience de soi et d’exploration de soi. Dans son travail de dessin, cette exploration de l’intérieur correspond à une obsession pour une pénétration potentiellement infinie des structures de surface jusqu’à une échelle nanométrique insondable. Cette envie de profondeur donne aux dessins d’Ines Panier une touche incomparable de diaphanatie et de fantastique. Ici, la réalité photographique se transforme en une zone informelle, dans laquelle il n’y a pratiquement pas d’orientation rétinienne. Les références motiviques répétées à la tactilité et à l’aveuglement mènent au cœur des dessins.Ines Spanier est une artiste qui se caractérise non seulement par un niveau de réflexion étonnamment élevé et par l’individualité et la profondeur de son travail. Le radicalisme et la cohérence avec lesquels elle écrit sismographiquement la vie comme une sorte d’auto-expérience et la matérialise et la condense ainsi, sans succomber à une rhétorique conceptuelle unidimensionnelle, est sans précédent dans l’art contemporain.
Alexandre
Longjun Zhang : Les thèmes chers à Longjun Zhang sont les paysages, les objets du quotidien, les hommes…
Un homme est affalé dans un fauteuil, deux autres se mettent nus, un autre est assis face à nous prenant appui sur ses coudes, d’autres s’étreignent. L’homme marque là le point de tangence du vide et de la stabilité. Leur irréciprocité, sauf un couple qui s’enlace, est génératrice d’interrogation presque de mystère.
Les paysages sont plus apaisés. À la première lecture, ces déserts où toute présence humaine est effacée jettent le trouble tant l’image picturale, par une puissance qui frappe le regard, garde ses distances avec un regardeur possible. Les couleurs souvent presque sourdes réagissent à l’intérieur de leur propre lumière aux limites d’un silence et d’un calme apaisant. L’usage de la brosse et de pinceaux de différentes tailles permet à la peinture de se déployer et de faire surgir des transparences et une cosmogonie écrite dans les ombres et les lumières.
À ces deux séries bien identifiées, s’ajoutent des toiles de petit format sur la thématique de la main. Dotées d’une grande puissance suggestive, elles traduisent l’expression des sentiments et de la pensée, rappelant que dans la pratique de la peinture occidentale et de la calligraphie chinoise que Longjun connaît bien, la main qui tient le pinceau est une mémoire sans paroles, une mémoire d’expérience, faite de transmission, et fondée sur une accumulation d’apprentissages et d’oublis.
Communauté
Toutes les offres
Ces prix incluent les frais de services appliqués par les distributeurs.
11:30- 15:30